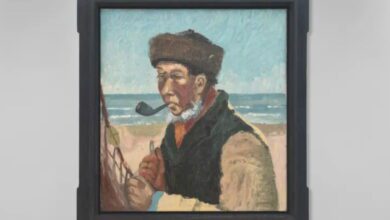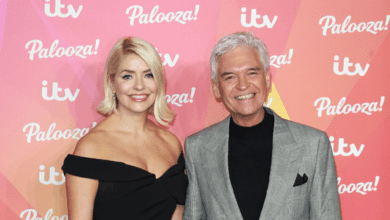Les animaux de compagnie sont les bienvenus dans les musées de Vélez-Malaga
Entrée au musée autorisée aux animaux de compagnie

À l’occasion des célébrations de San Antonio dans toute l’Espagne, la mairie de Vélez-Málaga a annoncé une nouvelle expérience muséale qui permet aux animaux de compagnie d’entrer avec leurs propriétaires.
L’événement aura lieu le samedi 18 janvier dans plusieurs musées de la ville. La conseillère municipale de la Culture et du Patrimoine historique, Alicia Ramírez, a souligné l’union entre « l’art et l’amour des animaux », un élément que l’événement tente de mettre en valeur. Elle a également déclaré qu’elle espère que de nombreuses personnes profiteront de cette journée « tous ceux qui veulent venir accompagnés de leurs animaux de compagnie. Chiens, chats… nous voulons que les propriétaires et leurs animaux de compagnie puissent visiter nos salles d’art ».
Les musées suivants acceptant les animaux de compagnie permettront aux résidents d’emmener leurs animaux de compagnie à l’intérieur pendant une journée à Vélez-Málaga.
Il s’agit du Centre d’Art Contemporain Francisco Hernández (CAC), du Musée de la Ville de Vélez-Málaga (MVVEL) et du Musée de la Semaine Sainte et de la Salle Cervantes.
Les visiteurs et leurs animaux de compagnie auront également droit à d’autres événements ce jour-là, et pas seulement à la possibilité de consommer des œuvres d’art aux côtés de leurs animaux de compagnie dans des zones normalement interdites.
De nombreuses activités auront lieu tout au long de la journée, notamment une lecture théâtrale du roman Le Dialogue des chiens de Miguel Cervantes dans la cour du MVVEL à 12h00. Cervantes fera une visite théâtrale de la Maison Cervantes dans le centre-ville et le Théâtre del Carmen présentera la pièce L’Âne à 20h00, avec la participation de l’acteur de renom Carlos Hipólito.
En savoir plus sur les festivals de l’Axarquia ici.